La chronique « Tout doit disparaître » de Marie Misset, à retrouver toute la semaine dans la matinale.
Qui n’a pas un jour hésité à dire à un ami, un parent, qu’il se sentait un peu flappi ? Un peu déprimé ? Triste à en chialer ? Par peur d’être regardé comme la personne qui va toujours mal, qui ne fait pas d’effort.
Il est loin le XIXe siècle des romantiques, quand, pour les poètes, le spleen était le dernier chic. Aujourd’hui si on va mal, c’est qu’on y met du sien, et ça se fait pas. Dans un essai intitulé Le Syndrome du bien-être, André Spicer et Carl Cederström estiment que l’obsession que nous avons pour notre bien-être nous pousse à considérer les personnes malheureuses, ou carrément en mauvaise santé, « en des termes moraux », comme des personnes irresponsables ou même mauvaise, qui ne prennent pas soin d’elle.
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Une émission diffusée il y a quelques années sur M6 ne disait pas autre chose. Dans ce programme certainement pavé de bonnes intentions qu’était Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? on sous-entendait très clairement que si on se prenait enfin en main, on pouvait être heureux et donc, que ceux qui n’en n’étaient pas capables, ne faisaient tout simplement pas ce qu’il fallait.
Smile Or Die, a résumé dans un livre l’auteure américaine Barbara Ehrenreich. Mais qui a-t-il de mal à chercher le bonheur ? Est-ce qu’on n’est pas là pour ça ? Est-ce que ce n’est pas chouette une application comme Happify dont nous parle Usbek et Rica dans un article consacré à l’ouvrage Happycratie ?
Happify est une application, utilisée par trois millions de personnes et qui coute 12 dollars par mois, qui vous permet de suivre votre score de bonheur, et avoir un bilan quotidien de votre santé émotionnelle, et tout ça, grâce à la science.
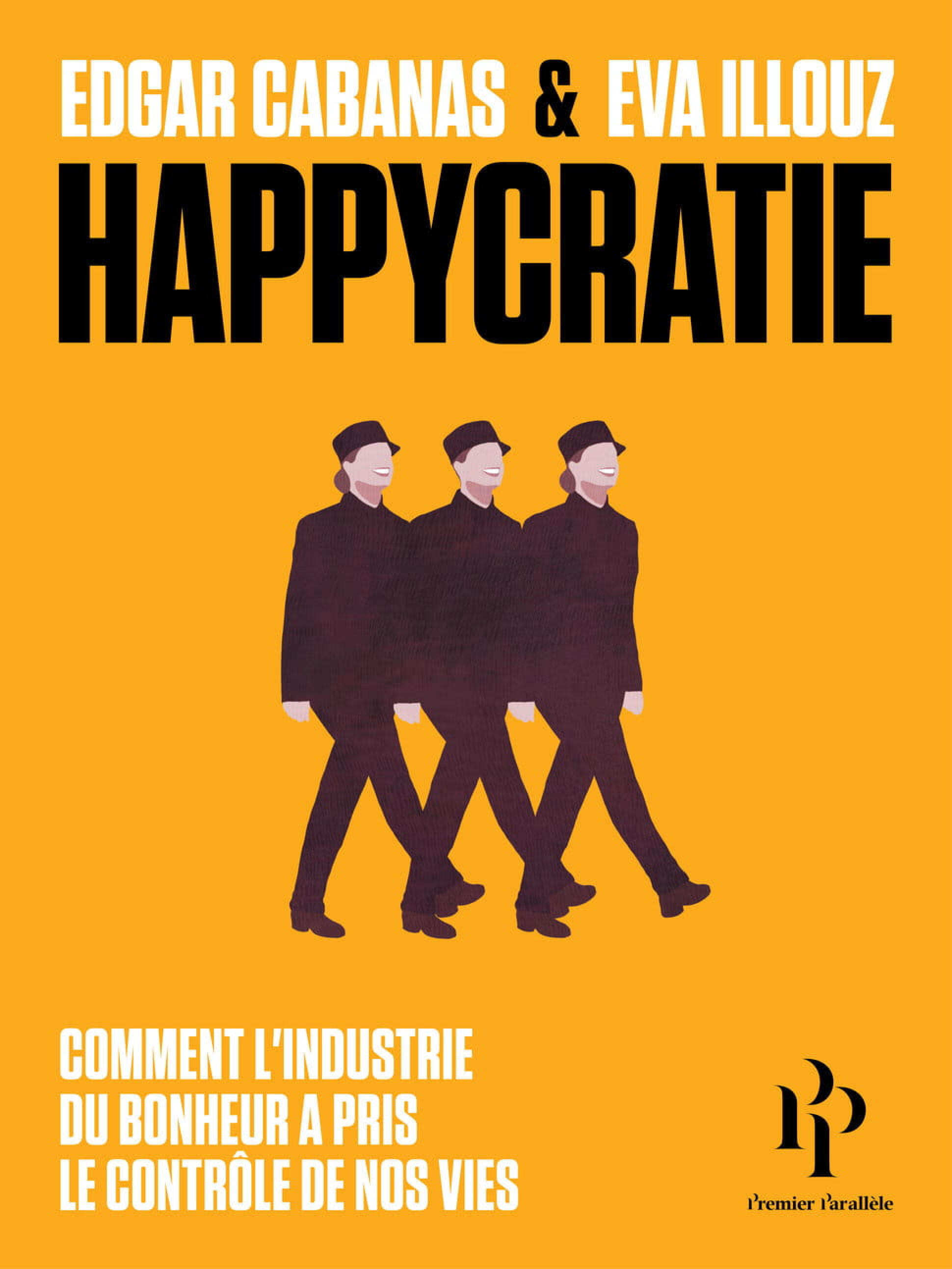
Cette application qui promet le bonheur est une toute petite partie de la partie émergée de l’Iceberg, de cette industrie du bien-être qui rapporte un pognon de dingue : 10 milliards pour la seule année 2017 aux États-Unis. Edgar Cabanas et Eva Illouz, les auteurs du livre Happycratie, sorti en août aux Éditions Premier Parallèle, estiment que cette injonction permanente au bonheur est presque dictatoriale et surtout, nous éloigne du collectif.
« Dans la mesure où les individus se convainquent que leur destin est une simple affaire d’effort personnel et de résilience, c’est la construction collective même d’un changement sociopolitique qui se trouve hypothéquée ou du moins sérieusement limitée. »
En quelques mots, à force d’ériger le bonheur personnel en valeur cardinale, voire presque en droit, il est plus facile de se concentrer sur soi, de fermer les yeux sur son environnement. Après tout, puisqu’on a le droit au bonheur, mieux vaut les garder fermer, les ouvrir peut s’avérer beaucoup trop déprimant.
À la poursuite du bonheur ? Pour quoi faire ?
Qui ne s’est pas déjà pas coupé quelques jours des infos pour préserver sa santé mentale ? Dans un monde où les informations arrivent en rafale, le mouvement de repli sur soi peut être salvateur, mais poussé à l’extrême, il abime aussi.
Et puis cette recherche insatiable de bonheur qui nous fait regarder les malheureux de travers, finit par se mordre la queue et nourrir ce que les auteurs appellent des happycondriaques, qui en poursuivant le bonheur, le voit toujours plus loin ou pire, se sentent nuls de ne pas y accéder, malgré tous leurs efforts.
On n’a jamais vendu à la fois autant de livres de développement personnel et d’antidépresseurs.
Visuel (c) Blue Jasmine / Woody Allen / Cate Blanchett













































