Interview de George Pelecanos, scénariste et romancier américain
George Pelecanos est un écrivain et scénariste américain. D’origine modeste, il est fils d’immigrés grecs. Depuis bientôt 20 ans, il écrit des polars sur et à Washington, sa ville natale. Récemment conquis par l’atmosphère de la Nouvelle-Orléans, il a également élargi son champ de compétences en travaillant aux scénarii de The Wire, Treme et The Pacific, 3 séries phares et ultra réalistes de la chaîne américaine HBO. Retour sur un personnage fascinant, héraut moderne du réalisme noir et parangon sans égal de la critique sociale.
NB. Cette itw fera l’objet d’une publication en 5 parties, à raison d’un extrait par semaine. Ceci est la 3e partie.
Chaque extrait est accompagné d’une playlist musicale : honneur au funk cette semaine !
Vous redoublez de précision quand vous décrivez les sentiments de vos personnages ou les scènes de repas, de sport, de voiture… Le travail d’écrivain s’apparente-t-il, selon vous, à celui du journaliste ou de l’enquêteur ?
Oui, même si je n’ai jamais été journaliste à proprement parler. Je réfléchis et je construis mes histoires à partir de sources documentaires précises et réelles. Je veux être très précis ; je me pose toujours des questions à propos de mes personnages : d’où viennent-ils ? Que portent-ils ? Quelle voiture conduisent-il ? C’est vraiment ma manière de voir le monde quand je descends dans la rue. J’essaie de le retranscrire dans mes fictions.
Comment se passe votre travail de recherche ? Comment vous documentez-vous ?
A nouveau, le personnage de The Cut est très inspiré de ma propre vie. Il conduit une jeep, comme moi ; c’est un motard, comme moi ; un fan de kayak, encore comme moi. Pour écrire ce livre, je me suis baladé à moto dans Washington avec mon appareil photo. J’ai découvert nombre d’endroits décrits dans le livre au cours de ces pérégrinations à moto. Quand je découvre de nouveaux endroits, je discute avec les gens. Non pas que je sois un grand bavard, mais bizarrement où que j’aille, les gens prennent plaisir à me parler. Et moi, je les écoute.
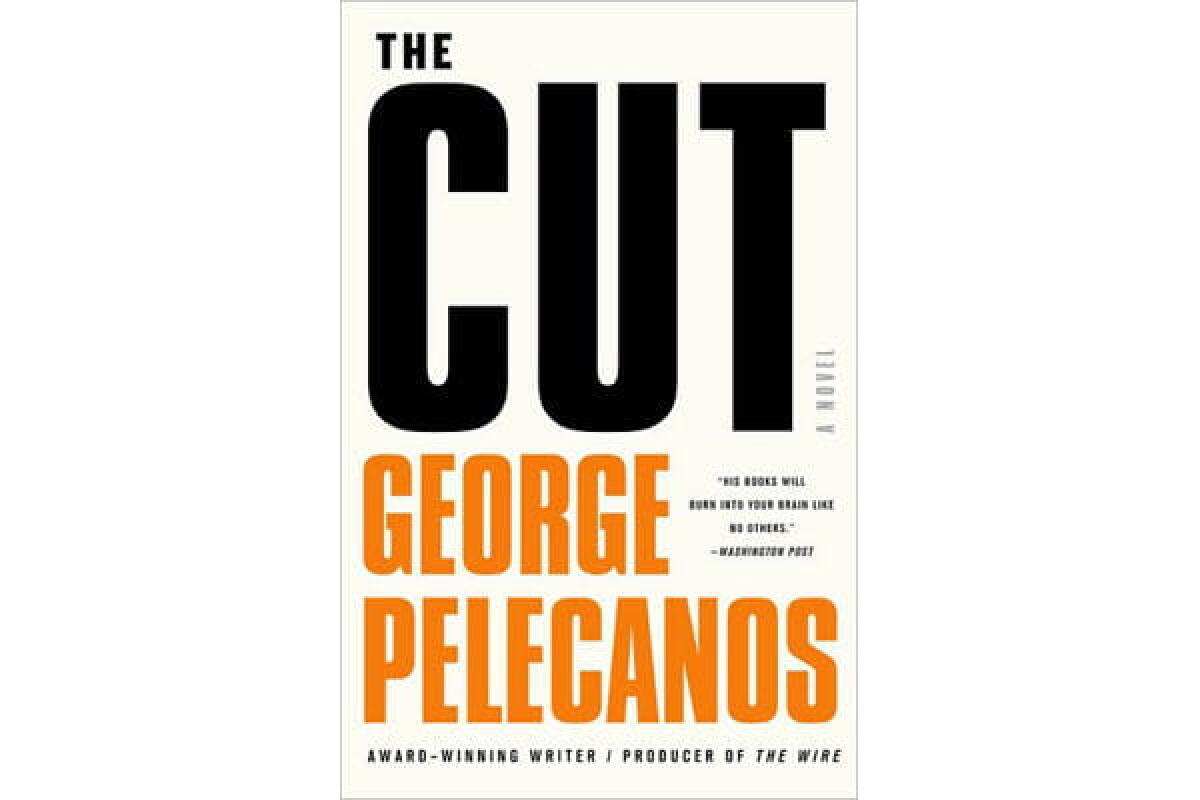
A vrai dire, je prends beaucoup de plaisir à faire ce travail préliminaire de “recherche”. Je suis dans la rue, dans mon élément, et pas du tout enfermé dans une bibliothèque.
Vous êtes très prolifique. Vous écrivez plusieurs livres à la fois ?
Non je compartimente tout. Je sais que je dois écrire mon livre en tant de jours, je m’assieds et j’écris. Quand je bosse pour la télévision, je fais des journées de 15 ou 16h pendant 6 mois. Je ne peux rien faire d’autre, à part dormir et manger un peu. Donc quand j’écris un livre, je me libère de mes obligations télévisuelles. Globalement, je ne prends jamais de vacances.
Vous vous imposez la même discipline et la même hygiène de vie que Nick Stephanos ou Spero Lucas : beaucoup de sport, lecture, alcool et douche ?
(Rires) Oui presque. Vous savez quand vous ne regardez pas la télévision, vous avez beaucoup de temps pour faire tout ce que vous devez faire. J’aime pas perdre mon temps bêtement devant l’écran. Je vais faire des choses sensées : manger de la bonne cuisine, boire du bon vin, lire de bons livres, voir de bons films… Quand on arrête de regarder la télé, on est étonné de tout ce qu’on peut faire en une journée.
C’est un peu étrange d’entendre ça de la bouche de quelqu’un qui travaille pour la télévision ?
(Rires) Je sais. Bon, je dois admettre que ça m’arrive de regarder le foot et le basket. Elle sert au moins à ça.
Il y a beaucoup de scènes de sport et de douche dans The Cut. C’est un moyen pour Spero Lucas de se laver de ses pêchers ?
Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne l’ai pas pensé en ce sens. Au demeurant, mon prochain livre comprendra beaucoup de scènes de sexe. Vous devriez adorer. Un homme tombe amoureux d’une femme et leur rencontre est très “visuelle”.
A ce propos, Spero Lucas refuse de tomber amoureux…
Il refuse de s’engager. Il n’est pas conscient de faire quelque chose de mal. Quand il couche avec une femme, c’est parce qu’il en a l’opportunité. Il fait ça pour le plaisir. A la fin du livre, quand il se balade à vélo dans la ville, il n’est pas conscient de ce qu’il a perdu. C’est juste un jeune homme insouciant. Rappelons-nous qu’il a été absent pendant longtemps, il essaie de rattraper le temps perdu.
C’est dur pour les hommes de montrer leurs sentiments
Vos personnages sont souvent capables de tuer à l’envi, mais incapables de montrer leurs sentiments, comme Spero avec son frère…
C’est dur pour les hommes de montrer leurs sentiments. Les frères s’aiment profondément mais ne savent pas l’exprimer. Mais ils essaient…
Dans tous vos livres, il y a toujours 2 méchants, l’un qui a des scrupules, l’autre pas. Vous aimez les contrepoids ?
Oui, j’essaie d’humaniser tous mes personnages. Je ne crois pas que l’on puisse être foncièrement méchant. D’ailleurs je ne supporte pas de lire un livre ou de voir un film dans lequel il y a un vrai méchant sans nuances. Le père dans le livre, Rusty, est un de ces vrais méchants qui n’aime personne, pas même son fils qu’il instrumentalise. Mais en fait il a un cancer, c’est un personnage plus complexe qu’il n’en a l’air.
Et son partenaire, Mobley, vous pouvez nous en parler ?
Il n’a pas l’impression de faire de mauvaises choses. C’est juste un type qui aime s’amuser, prendre de la coke, se faire des filles. Il n’est pas vraiment méchant. Malheureusement, il blesse des gens. Il est pris dans une affaire qui le dépasse, même s’il participe délibérément.
On dirait que vous, Georges Pelecanos, êtes un mélange du jeune Ernest Lindsay, de Spero Lucas et de Peterson, l’avocat, non ?
Peterson est inspiré d’un procureur que je connais. Je serais plus proche d’Ernest Lindsay. Il vit dans un quartier d’où la plupart des jeunes n’imaginent jamais sortir et s’élever dans la société. Je rencontre souvent ce genre de situations. J’interviens régulièrement dans des écoles et des prisons de Washington. J’essaie de donner envie à mon public de travailler, d’étudier…etc. Je n’explique jamais à mon public comment ils peuvent devenir comme moi, écrivain, je leur dis simplement : « Ne pensez pas que vous êtes différent de moi ». J’étais un enfant américain d’origine grecque qui n’avait juste aucune idée de la manière dont il deviendrait auteur ou scénariste. Je me suis juste mis au boulot ; j’ai tenté ma chance. On ne devient pas écrivain ou scénariste pas hasard ; il faut le vouloir et peu importe qu’on ait des contacts ou pas. Moi, j’en avais pas. Ernest est un jeune qui cherche son chemin, attend l’assentiment et l’aide de ses pairs – ce que Leo et Spero finiront par lui donner.
Vous êtes apparemment accro au cinéma. Des rumeurs disent que vous vous êtes inspiré de The Killer de John Woo et du premier film des Frères Coen ?

Oui, au début de ma carrière, j’ai travaillé pour une société de distribution qui s’est occupée de ces 2 films. J’étais aux premières loges. Une belle éducation cinématographique ! Mon boss là-bas était aussi mon mentor. On a d’ailleurs produit quelques films ensemble dans les années 90. J’y ai appris tout ce que j’avais besoin de savoir. Aussi, quand quelques années plus tard je rentrais dans le bureau d’un directeur à Hollywood ou New York, je savais de quoi il me parlait et comment je devais réagir. Je demeurais certes écrivain mais conscient des mœurs du milieu.
Pourquoi êtes-vous resté à Washington plutôt que d’aller à Hollywood ?
Je suis resté parce que je voulais continuer à écrire sur Washington et parce que je voulais veiller sur mes parents. Ça peut paraître un peu ennuyeux comme excuse, mais je suis très content d’être resté. Ça m’a permis de m’affirmer comme auteur. Si j’étais parti vivre à Hollywood, j’aurais été un scénariste parmi tant d’autres ; alors qu’en continuant à écrire des romans, j’ai affiné mon style et suis devenu un meilleur scénariste, et vice versa.
Et finalement c’est Hollywood qui est venu à vous…
Oui. En pratique, David Simon m’a appelé. Il avait lu un de mes livres. Il m’a parlé de son projet de série pour HBO, The Wire. Il venait de leur vendre en fait, et m’a dit simplement que ça parlait de flics et de dealers de drogues. Pas de longues déclarations. Je lui ai dit : « d’accord, je vais essayer ».
Au début, j’avais vraiment aucune idée de ce qu’était la série. C’est au fil du temps, surtout quand on a tourné la 2e saison que je me suis rendu compte qu’on faisait quelque chose de grand et d’inédit à la télévision.
Puis, il y a eu Treme…
J’avais beau ne rien connaître à la Nouvelle-Orléans, je suis tombé amoureux de la musique, la culture, la cuisine…

Pour Treme, j’y suis allé les yeux fermés. J’avais beau ne rien connaître à la Nouvelle-Orléans, je suis tombé amoureux de la musique, la culture, la cuisine… De plus c’est une ville noire, comme Washington, je m’y sens très à l’aise. Ca m’a transformé au point d’être prêt aujourd’hui à quitter ma ville natale. Vous vous rendez compte ?
En parlant de films “black”, avez-vous vu Django Unchained, le dernier long métrage de Quentin Tarantino ?
Oui je l’ai vu.
Qu’en avez-vous pensé ?
C’est bête. Traiter le problème de l’esclavage de cette manière, comme une blague, c’est juste nul. Ca ne marche pas du tout. Je ne suis pas contre Tarantino dans l’absolu, il a fait des films brillants, mais là c’est un film archi-violent qui tombe à côté de la plaque. Si vous prenez un film comme Drum (1976), vous voyez qu’on peut exploiter le thème de l’esclavage à des fins humoristiques sans se planter. Si le film avait eu la même audience que Django, il aurait eu bien plus de prix.

Vous comprenez la polémique avec Spike Lee ?
Oui, je comprends. Je ne suis pas ami avec Spike, mais je m’accorde avec lui pour considérer qu’il n’était pas du meilleur goût de faire western spaghetti avec un sujet aussi délicat. Par exemple, je déteste utiliser le mot « nègre » (negro)– ce que le film fait à volonté. Il doit comprendre qu’il ne peut pas faire ça ; il n’est pas en posture de le faire. Si vous regardez bien dans mes livres, j’évite au maximum de l’employer. Je déteste le son de ce mot.
C’est pourquoi vous considérez Hard Revolution (2003) comme votre meilleur livre ?
Je crois bien, oui. J’ai mis beaucoup de temps à l’écrire, un an à peu près. L’intrigue se déroule sur fond de bouleversements politiques, durant le second événement le plus important dans l’histoire de Washington (l’assassinat de Martin Luther King, le 4 avril 1968, et les émeutes qui s’ensuivirent dans tout le pays, ndlr). Même si à l’époque je n’avais que 11 ans, je m’en souviens comme si c’était hier. Je ne voulais pas aborder ces évènements cruciaux de front ou quand j’étais trop jeune. J’ai attendu d’avoir une certaine expérience d’écrivain pour l’écrire. Au final, l’histoire semble bien fonctionner. Même si le bouquin n’a pas fait un tabac d’un point de vue commercial – très peu de monde en a parlé – je crois que c’est surtout lui qu’on retiendra après ma mort.
Pourquoi ? Parce qu’il traite d’un sujet qu’on passe souvent sous silence ?
Ce que j’aime dans ce livre, c’est qu’il télescope l’histoire personnelle d’une famille ouvrière de Washington et des évènements qui ont eu un retentissement national. Ces évènements vont transformer leur monde, leur quotidien. James Ellroy écrit sur la manière dont des hommes blancs et puissants changent le cours de l’histoire. De mon côté, j’essaie de voir en quoi ces changements peuvent affecter les prolétaires.
J’aime bien les sagas familiales ; ce genre de fictions est assez rare aux Etats-Unis.
Suite de l’interview le mardi 11 juin, sur Novaplanet.
Interview : Reza Pounewatchy
Traduction : Quentin M





































