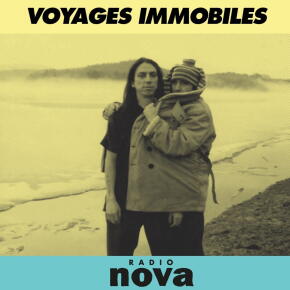Une plongée et une bouffée d’air depuis le Festival International du Jazz à Montréal.
En atterrissant à Montréal, pour le Festival International de Jazz, il faut avouer que l’on ne savait pas exactement avec qui nous allions vivre l’expérience. Vaste question que de savoir qui fait le jazz en 2023, à laquelle le réel s’occupe de nous répondre rapidement. Embarqués dans une navette qui file vers le Quartier des Spectacles, où tout se joue, il y a là avec nous des jeunes tout juste atterris de Los Angeles et San Francisco.
Le jazz : pour tout le monde
L’un est un bassiste, dont les cheveux sont teints comme le pelage d’un léopard, qui raconte avec la voix des joyeux lendemains un concert qui s’est terminé quelques heures avant son vol. Il est déjà venu, il y a des années, et même s’il vient de passer une courte nuit, on entend son excitation de remonter sur scène ici. L’autre est un journaliste habitué du festival, qui épluche le programme pour se fabriquer le planning parfait. Et ensemble, ils discutent : de tel batteur qui a sorti un disque exceptionnel, de Thundercat qui sera ce soir sur scène, du dernier Tiny Desk qui les a époustouflés. Passionnés, enthousiastes, blagueurs, noceurs, ils sont d’un cool absolu et donnent le la de ce que nous allons vivre.

Cet été 2023, c’est la 43ᵉ édition de ce festival dont voici les contours. Ici, tout est central, au cœur donc de ce Quartier des Spectacles agencé autour de la Place des Arts et de la Place des Festivals, que les Montréalais ont l’habitude d’arpenter. Tout est aussi populaire parce qu’une bonne partie de la programmation du festival est gratuite. Oui. Thundercat, BadBadNotGood, Tank & The Bangas, Jupiter & Okwess, Nick Hakim, Son Little, Kokoroko, Cimafunk, Naïssam Jalal, Gabrielle Shonk, Jean-Michel Blais, Ko Shin Moon, Kieffer, Geneviève Artadi, Isaiah Collier, Kassa Overall, DJ Premier ont tous joué cette année gratuitement, en plein air, sur des scènes ouvertes et accessibles — même en cas de forte affluence. À une époque où tout coûte de plus en plus cher, l’attachement à ce principe sonne aussi comme un pied de nez aux concerts inflationnistes et comme le meilleur moyen de continuer à ancrer le jazz dans la culture du public québécois. Ce qui n’empêche pas au festival de proposer certains spectacles payants.

Au contraire, c’est toute l’idée géniale du FIJM (permettez-nous les initiales) : il y a ici suffisamment de public pour faire payer l’accès à des concerts rares et exclusifs. Cette année, ce sont Chucho Valdes, Robert Plant, Natalia Lafourcade, November Ultra, Teke Teke, Dakhabrakha, Diana Krall, Roberto y Gabriela, les Snarky Puppy, los Hermanos Gutiérrez, Hiromi, Avishai Cohen Trio, Vieux Farka Touré, Herbie Hancock ou Marisa Monte qui ont rempli chacune des salles où ils étaient invités et la promesse de s’inscrire dans la mémoire des spectateurs.

Le plus beau terrain de jeu qui soit.
Maurin Auxéméry
Mais qui organise une telle programmation ? C’est notamment Maurin Auxéméry, qui a hérité de cette tâche et de cet honneur cette année, succédant à Laurent Saulnier. Il nous raconte les défis que représente une telle organisation, les concerts qui s’étirent sur tant de scènes et tant de jours. Immensément fier d’écrire le présent et l’histoire de ce festival dont il nous parle comme du “plus beau terrain de jeu qui soit”, on le retrouve le dernier soir. Il nous tire par le bras, pour faire face à la foule et admirer la marée humaine. Il est ému : c’est le tout dernier concert de cette édition. Ce devait être Macy Gray mais elle a annulé. Alors c’est The Brooks qui jouent. Qui ? The Brooks, un groupe de jazz funk de Montréal. D’excellents musiciens, mais qui n’ont pas l’habitude de jouer devant des dizaines de milliers (au bas mot) de personnes. Peu importe : l’audace de ce festival, c’est de se dire qu’ils vont assurer. Et la puissance du public, c’est de les accueillir et de recevoir leurs ondes à leur juste valeur.
Cette marée humaine, on la retrouve chaque soir, à chaque concert devant la scène TD. Elle n’est pas uniforme pour autant : à BadBadNotGood, on la devine anglophone et jeune, pour DJ Premier & The Badder Band, nostalgiques du “50ᵉ anniversaire” que le rappeur et le musicien et son bigband entendent fêter, etc. C’est que tout le monde trouve sa place ici.

Parce que Maurin Auxéméry connaît Montréal et le public du festival pour lequel il travaille depuis près de 10 ans. Il sait leur diversité : certains ne connaissent aucun nom de l’affiche mais viennent chaque année en famille, entre amis ou en premier rendez-vous, passer une après-midi ou une soirée sur l’herbe. D’autres sont des fidèles depuis 40 ans, des érudits du jazz dont la culture a été nourrie au rythme des concerts mythiques qui ont eu lieu ici (Sarah Vaughan, Oscar Peterson, Stevie Wonder, Pat Metheny, Prince, Léonard Cohen, Miles Davis, Esperanza Spalding, Ella Fitzgerald, Erykah Badu, mais on s’épuiserait à tous les nommer). Fins connaisseurs, ils sont aussi habitués à tendre les oreilles vers l’inconnu — conscients qu’une légende commence toujours par être autre chose. Et puis il y a les néophytes, portés vers le jazz plus récemment grâce aux ponts avec le hip-hop, les musiques électroniques, la folk. Cela tombe bien : le Festival tient à s’attacher à une idée du jazz la plus généreuse possible, que chaque concert vient enrichir de sa propre définition, et la période est particulièrement enthousiasmante pour le genre.

La diversité dans les formes, la diversité dans les propos
Maurin Auxéméry nous le confirme, il y a une nouvelle génération à laquelle il peut s’adresser, pour qui le jazz se pense et se danse aussi. On lui cite Manu Dibango, qui avait évoqué au micro de Radio Nova l’époque funeste où le jazz autrefois dansant avait perdu ses jambes pour ne plus toucher que la tête. Maurin acquiesce : le jazz, ça se vit avec tout le corps. Ce qui rend le travail en amont du festival d’autant plus excitant, quand il s’agit d’écouter le monde entier — sur scène, parmi ce laboratoire que sont les Tiny Desk ou sur disque — pour découvrir de nouvelles voix. Ce que l’on entend ici est né en Turquie ou dans une réserve abénaquise, à Londres, en Afrique du Sud, au Nigéria, en Belgique ou à Cuba. À nouveau cette diversité, dans les formes et le propos.

Pour Mali Obomsawin, contrebassiste qui a grandi en étudiant les structures classiques, c’est finalement grâce à la liberté fondamentale du free-jazz qu’elle s’épanouit. Plus encore, c’est là qu’elle trouve le chemin pour dire son histoire et celle de la première nation Odanak à laquelle elle appartient. Ne lui parlons pas de racines : les chants, les contes, la spiritualité, les luttes politiques font partie de la sève qui coule en elle à chaque instant. Ce n’est pas un folklore qui sommeille, ni un passé auquel elle veut rendre honneur, c’est son présent et le futur vers lequel elle espère tourner son public. Inspirée par des contrebassistes comme Esperanza Spalding, elle est honorée de jouer ici comme elle, devant une audience qu’elle sait hardie et soucieuse de la question autochtone. À quelques instants de son concert, elle nous raconte qu’elle est prête à improviser parce qu’elle fait confiance à la foule, qui se presse déjà aux portes de la salle, et aux musiciens qui l’accompagnent et vont métamorphoser l’intime de son disque en une grande expérience live et collective.
À la manière de Kassa Overall, la veille. Si son disque nous avait déjà follement intrigués, son concert lui aura donné une ampleur inoubliable. Par les vibrations des percussions, les valses entre les genres et les références, et la transe qui nous attrape sans qu’on le réalise vraiment. Ces dernières années nous avaient habitués à voir des musiciens de jazz sur scène avec des rappeurs. Désormais, il faudra composer avec des jazzmen qui rappent.
De cette édition, on repart les bras chargés de découvertes musicales et émus. Par Chucho Valdes qui s’est saisi de son piano pour ériger Chick Corea au rang des icônes, comme Mozart, comme Rachmaninov. Par le public de Derya Yıldırım & Grup Simsek, chantant en chœur chacun des standards turcs repris par le groupe. Par ce fan de Robert Plant, vêtu d’un t-shirt Non Stop Go Tour 1998, arpentant impatient la ville des heures avant le concert. Par ces personnes d’un certain âge, vissées sur une chaise de camping à la meilleure place, pour ne pas perdre une goutte des concerts gratuits. Par l’idée même que le jazz est en train de redevenir le langage de celles et ceux qui résistent aux formats. Et finalement émus par les larmes du programmateur quand il nous raconte sa propre émotion face à cette image, d’un concert qu’on a loupé mais dont on ressent, même à distance, l’importance.
Pour aller plus loin, vous pouvez écouter les reportages d’Armel Hemme et Melvin Schlemer et écouter cette playlist non-officielle qui vous plongera en long, en large et en travers dans la programmation !