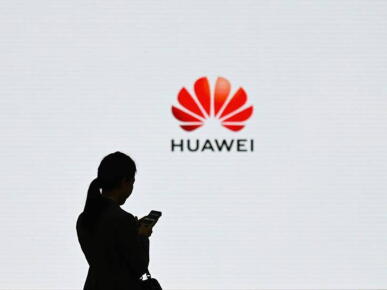« Le savoir occidental tente, depuis vingt-cinq siècles, de voir le monde. Il n’a pas compris que le monde ne se regarde pas, il s’entend. » (Jacques Attali, Bruits, p.1).
Vous vous en souvenez sûrement, c’était il n’y a pas si longtemps, et pourtant cela nous semble aujourd’hui si loin déjà. Avant la guerre en Ukraine, avant les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin, les yeux de la communauté internationale étaient braqués sur la région du Xinjiang, à l’extrême ouest de la Chine.
Cette province autonome de la République Populaire de Chine, coincée entre la Mongolie, la Russie, l’Inde et les cousins en « -stan » (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan) abrite entre autres le peuple ouïghour, l’une des cinquante-six minorités ethniques du pays. Cela fait maintenant plusieurs années que les révélations sur la surveillance de masse puis sur l’enfermement méthodique et arbitraire des membres de cette communauté musulmane se sont multipliés, amenant les États-Unis à qualifier la situation de « génocidaire », les grandes marques occidentales à se retirer de la région et la société civile à se mobiliser un peu partout dans le monde afin de dénoncer les exactions de Pékin à son égard.
Alors qu’un rapport très attendu de l’ONU sur la situation au Xinjiang tarde à être remis, l’organisation internationale a finalement confirmé la visite dans la région, au mois de mai, de sa Commissaire aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet. Même s’il est fort à parier que cette montagne – on parle de la première visite de ce type en Chine depuis 2005 – accouchera d’une souris – côté chinois, on parle d’une « visite amicale », vraisemblablement très encadrée – à Radio Nova, on a voulu s’emparer de cette occasion pour entendre des voix que l’on entend rarement, et qui pourtant sont celles des premiers concernés dans cette affaire : les artistes et musiciens ouïghours.
Comme l’écrivait Edgar Morin il y a presque cinquante ans, la musique populaire contribue à la construction d’un « imaginaire commun significatif » qui nous permet d’observer et de s’informer sur une réalité sociale. Écouter la musique venue du Xinjiang, c’est ainsi se plonger dans une tradition musicale ancestrale d’un peuple nourri par les échanges le long des routes de la soie, c’est également une autre façon de découvrir la vie moderne que partagent à travers leurs œuvres les plus jeunes musiciens ouïghours. Pour nous, qui en sommes si éloignés, c’est aussi et surtout une manière de prendre position et de reconnaître une langue, une histoire, un peuple et une culture que certains cherchent aujourd’hui à museler.
Afanti – « Qin Nuli » (1998)
La première fois que j’ai travaillé avec un artiste ouïghour, je lui avais demandé de partager avec moi la musique qu’il entendait chez lui, à la maison, quand il était jeune. Sa réponse avait été automatique : il faut écouter l’album Qin Nuli d’Afanti. Ce groupe, créé en 1997 avec des musiciens ouïghours, kazakhs et hans, a marqué son époque l’année suivante avec cet album qui mélange des influences venues du folklore local, du flamenco espagnol et du rock turc. Dans leur présentation sur les sites de streaming chinois, ils s’érigent en représentants de ce Xinjiang idyllique, « terre natale des danses et des chants ». Leur nom, Afanti, n’est pas sans rappeler le personnage éponyme d’une série d’animation que tous les Chinois nés après 1980 reconnaîtront. Dans « Les histoires d’Afanti » (阿凡提的故事), le héros est un jeune homme au turban et à la barbiche qui, accompagné de son âne dans les somptueux décors en papier du Xinjiang, surmonte les péripéties et brille par sa ruse et son intelligence.
Jam 乐队- « Aqil »(2020)
Chez les ouïghours, la musique fait tout aussi partie de la tradition que du quotidien. Dans le registre classique, le genre le plus connu et le plus étudié est le Muqam, un assemblage de longues suites musicales qui consiste en des poésies chantées, des histoires, des danses et de longs passages instrumentaux. Le Muqam a quelque chose de fascinant, en cela qu’on le jouait aussi bien dans les palais princiers que dans la rue, qu’une représentation peut s’étaler sur plus de vingt heures avec des artistes professionnels ou des amateurs, et qu’une telle performance relève tout autant de la musique que du religieux, voire de la méditation. Le Muqam rassemble aussi divers instruments locaux, qui font la particularité du paysage sonore du Xinjiang.
Mais plutôt que de vous présenter un morceau classique avec des instruments traditionnels ouïghours – chose que vous pouvez découvrir sur la BBC ou à la médiathèque du Quai Branly, j’ai choisi pour vous un morceau plus récent joué par la jeune formation Jam乐队. « Aqil » est une chanson tirée d’un poème d’Abduxaliq Uyghur, un poète nationaliste ouïghour, assassiné par le gouverneur chinois du Xinjiang en 1933. Ce poème a été repris plusieurs fois pour devenir un hymne révolutionnaire et de lutte contre l’impérialisme. Ici, le groupe Jam le magnifie avec un orchestre qui mélange à la fois instruments occidentaux (guitares, violons, basse) et ouïghours (ghijäk, rawap, dap).
Yiltiz – « 2km/8h » (2017) & Athree et Arslan – « Ghetto Boyz » (2019)
Il n’y a pas de modernité sans hip-hop, et cela vaut aussi pour le Xinjiang. Malgré le fait que le nord de cette région soit l’endroit sur terre le plus éloigné de tout océan, les sonorités rap ont tout de même réussi à se frayer un chemin jusqu’aux studios d’enregistrement d’Urumqi ou de Kashgar. Et la jeunesse ouïghoure de s’engager dans la brèche dès les années 2000, jusqu’à créer leur propre mythologie rap : Gangsa Mosa, Six City, Yiltiz sont désormais des formations historiques dont les rappeurs sont reconnus comme des barons du hip-hop régional. Dans le contexte actuel, rapper en ouïghour représente une double prise de position pour ces rappeurs : c’est en réalité s’emparer d’un produit culturel importé des États-Unis – une pollution culturelle dans le vieux jargon communiste – pour le réinterpréter dans un cadre culturel localisé, afin de représenter un espace, un peuple, une culture. C’est aussi une façon de réinterpréter la tradition musicale ouïghoure dans un cadre moderne, jeune et festif.
Pour illustrer cette section, partons d’abord pour la capitale du Xinjiang, Urumqi, plongée sous la neige hivernale dans 2km/8h d’Yiltiz. La première phase du morceau sonne comme un avertissement à l’adresse de ceux qui, victimes de l’ère moderne, courent dans tous les sens : « Même si tu ne cesses de regarder ta montre / Le temps ne se montrera pas clément avec toi ». Le deuxième morceau nous emmène quant à lui dans l’ancienne ville mongole de Bole, à la frontière du Kazakhstan, avec le rappeur Athree et le collectif HAS. Athree est le genre de rappeur très cash qui n’hésite pas à lancer à son public en plein concert « Si vous ne dansez pas, je vais jouer cette chanson dix fois, et si vous partez maintenant, alors je m’engage à vous rembourser votre billet ». Mais ce qui brille dans le morceau « Ghetto Boyz », c’est surtout l’hybridité culturelle qui s’en dégage est qui dit beaucoup des échanges interculturels à l’œuvre dans cette partie du monde : les rappeurs samplent « Les deux pigeons » d’Aznavour et rappent alternativement en ouïghour, en mandarin et en anglais. Vous l’aurez compris, c’est un morceau-monde.
Unut Meni (cover 2020) & Malikam (cover 2020)
Enfin, à l’heure des plateformes et des réseaux sociaux, des musiciens amateurs prolongent et enrichissent la création et la diffusion de la culture musicale du Xinjiang. Leurs morceaux se retrouvent sur Weibo, sur Douyin (la version chinoise de Tiktok), sur les plateformes de streaming musical chinoises où, à la différence de nos Spotify et consorts, tout un chacun peut partager ses créations en quelques clics. Grands anonymes, ces jeunes artistes se font le relai et la promotion d’une culture que les autorités cherchent à encadrer, ce qui nous donne encore plus envie de les passer à l’antenne.
Le premier morceau « Unut Meni », « Oublie-moi », est une reprise d’une chanson virale écrite par un guitariste ouïghour au début des années 2000. Chanson de rupture que l’on pourrait aussi interpréter sur un registre politique ? Les paroles du refrain peuvent laisser planer un doute : « Je ne serai pas esclave de conscience / Désolé ma belle, je ne suis pas ivre ».
Le deuxième morceau est, lui aussi, une reprise d’une chanson d’amour, « Malikam », postée sur le compte Douyin d’un jeune guitariste, REYIM. De lui, on ne sait presque rien, sinon qu’avec sa sœur Nndrea ils enregistrent et partagent des reprises de chansons dont certaines ont été compilées sur la plateforme de streaming 网易云. « Malikam » (parfois orthographié Melikem), est un morceau classique de folk interprété originellement par Lop Nur et qui a fait l’objet de nombreuses reprises. La viralité d’un tel morceau nous indique deux choses : la première, qu’il est nécessaire de nuancer la destruction culturelle à l’œuvre dans le Xinjiang – la musique folklorique ouïghoure est tolérée par les autorités dans certains contextes – la deuxième, que la musique populaire possède toujours de multiples lectures que chaque auditeur décode selon sa propre situation. De notre côté, on ne peut s’empêcher de penser, à la lecture des paroles, à la nostalgie d’un cœur en exil, chantant le déracinement de sa terre natale : « Ma princesse, tu es la plus belle / Ton sourire lui aussi est si beau / Tu as touché mon cœur / Tu es toujours dans mes chansons ».
Air / Zenjir / Mahir – « One Mic »(2014)
Et puisque dans l’histoire de Nova, l’histoire du hip-hop occupe une place bien particulière, on termine avec une track bonus, une archive musicale qu’il a fallu déterrer des fins fonds d’internet pour vous la partager. « One mic » est le genre de morceaux de rap qui a marqué une génération, qui a inspiré toute une scène et qui offre à celui qui le connaît en dehors du Xinjiang le statut respecté d’original gangster.
On vous parle d’un morceau bilingue ouïghour/mandarin sorti pendant l’âge d’or du crew Gangsa Mosa et qui rassemble deux monolithes du rap du Xinjiang, Air et Zenjir. « One mic » c’est la genèse du rap ouïghour, le moment où tout devient sérieux. « C’est de là que je viens / Le West Side / Je ne m’arrêterai pas de rapper […] Même si je quitte mon job ou pire / Je crois que Gangsa Mosa a un grand futur / J’ai une dignité que tu n’achèteras pas avec ton argent ». Tout semble dit. Et si ça grésille dans votre radio, c’est normal, ne vous inquiétez pas : ce son vous arrive tout droit des sous-sols d’Urumqi.
Pour aller plus loin :
Filip Noubel. “Interview: ‘Uyghur pop music humanises and amplifies their hopes’ says music expert Elise Anderson.” Hong Kong Free Press, 25 août 2020.
Dr. Rachel Harris et Yasin Muhpul. “Uyghur Music.” World Uyghur Congress« , 7 décembre 2009.
ABK. “Defender”, documentaire sur le rap du Xinjiang. Youtube, 26 octobre 2020
Photo de une : © Yilitz (capture d’écran du titre : « 2Km/8h »)